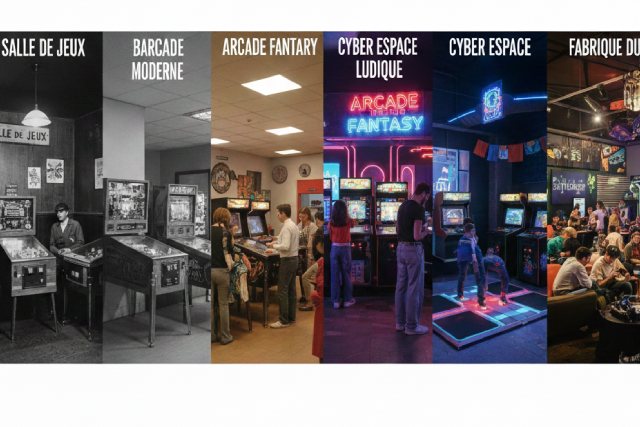prolapsus génital
Le prolapsus génital, également appelé descente d’organes, est une affection courante chez les femmes, plus à soutenir correctement les organes pelviens (utérus, vessie, rectum), qui s’affaissent alors dans le vagin, voire en dehors. Bien que rarement dangereux pour la vie, le prolapsus peut affecter de manière significative la qualité de vie des femmes concernées. Heureusement, plusieurs approches thérapeutiques existent pour le traiter efficacement.
Comprendre le prolapsus génital
Le prolapsus peut impliquer différents organes :
- Cystocèle : descente de la vessie,
- Rectocèle : descente du rectum,
- Hystérocèle : descente de l’utérus,
Les principaux facteurs de risque sont les accouchements par voie basse, le vieillissement, la ménopause et la génétique.
Traitement conservateur du prolapsus génital
Les traitements non chirurgicaux sont privilégiés en première intention, notamment pour les formes modérées ou en l’absence de gêne importante.
1. Rééducation périnéale
La kinésithérapie périnéale vise à renforcer les muscles du plancher pelvien. Elle est particulièrement recommandée en post-partum ou en prévention. Les exercices de Kegel, biofeedback ou stimulation électrique peuvent améliorer le tonus musculaire et retarder la progression du prolapsus. Ce traitement peut soulager les symptômes légers à modérés et prévenir l’aggravation.
2. Utilisation de pessaires vaginaux
Le choix dépend du type et du stade du prolapsus. Le pessaire est une solution efficace chez les femmes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas subir d’intervention chirurgicale. Il nécessite un suivi régulier pour éviter les irritations, infections ou ulcérations vaginales. Associé à un traitement œstrogénique local, il est mieux toléré chez les femmes ménopausées.
Traitements chirurgicaux du prolapsus génital
Lorsque les mesures conservatrices échouent ou que le prolapsus est sévère (grades III ou IV), la chirurgie devient une option.
- Chirurgie par voie vaginale
C’est la voie la plus utilisée, notamment chez les femmes âgées ou présentant des comorbidités. Elle permet d’accéder aux organes pelviens sans ouvrir l’abdomen.
- Colporraphie antérieure ou postérieure : réparation des parois vaginales (vessie ou rectum).
- Hystérectomie vaginale : retrait de l’utérus en cas de prolapsus utérin important.
2. Chirurgie par voie abdominale ou cœlioscopique
Ces techniques, souvent mini-invasives, sont réservées aux patientes jeunes et actives ou en cas de récidive. La plus connue est la sacrocolpopexie : le vagin (ou l’utérus) est fixé au promontoire sacré par une prothèse en maille synthétique.
- Chirurgie conservant l’utérus
Chez les femmes jeunes souhaitant conserver leur utérus, des techniques comme l’utéro pexie (suspension de l’utérus aux ligaments solides ou au sacrum) peuvent être proposées. Elles permettent de corriger le prolapsus tout en préservant la fertilité potentielle.
Après la chirurgie : récupération et prévention
En général, une convalescence de quelques semaines est nécessaire, avec des restrictions d’efforts physiques, d’activité sexuelle et de port de charges lourdes. La reprise progressive des activités est essentielle.
La rééducation périnéale postopératoire est souvent indiquée pour consolider les résultats. Une bonne hygiène de vie est également primordiale : contrôle du poids.
Conclusion
Grâce aux avancées en gynécologie, les traitements sont nombreux et permettent une prise en charge personnalisée. Qu’il s’agisse de rééducation, de pessaires ou de chirurgie, le choix doit être fait en concertation entre la patiente et le professionnel de santé, en tenant compte des symptômes, du mode de vie et des attentes. Une approche globale, préventive et curative, garantit une meilleure qualité de vie et réduit le risque de récidive.
Pour une meilleure pris en charge, voir TRAITEMENT PROLAPSUS GENITAL CASABLANCA